Comparatif du coût d’un véhicule électrique et d’un véhicule à essence
Comparatif du coût total sur cinq ans
Le coût total de possession (TCO) sur cinq ans regroupe toutes les charges liées à l’usage d’une voiture particulière pendant 60 mois. La formule retenue suit la logique suivante : TCO = dépréciation + énergie + maintenance/pièces d’usure + assurance + taxes locales/immatriculation + équipements de recharge (si électrique). L’analyse s’applique à des berlines compactes vendues neuves en France en 2025, motorisation électrique à batterie d’un côté et essence de l’autre, avec un kilométrage de référence de 15 000 km/an.
Prix d’achat et valeur résiduelle
La dépréciation résulte du débours initial net moins la valeur de revente à cinq ans. Pour l’électrique, l’acheteur sort 31 000 € après bonus et revend à 15 750 € (45 % de 35 000 €) : la dépréciation s’élève à 15 250 €. Pour l’essence, débours de 25 000 € puis revente à 10 000 € (40 %) : dépréciation de 15 000 €. L’écart de 250 € en faveur de l’essence sur ce poste reste modeste dans ce cadrage. La dynamique réelle dépend de l’attractivité du modèle à l’occasion, de l’évolution perçue de l’autonomie batterie, et de la politique d’incitations. Une batterie couverte par garantie 8 ans/160 000 km rassure souvent l’acheteur d’occasion et soutient la cote.
Énergie et rendements de charge
Sur 75 000 km, l’électrique consomme 16 kWh/100 km, soit 12 000 kWh à la roue. En intégrant 10 % de pertes, l’énergie livrée au compteur atteint 13 200 kWh. Avec 80 % des recharges à domicile à 0,24 €/kWh et 20 % sur réseau public à 0,45 €/kWh, le tarif moyen pondéré ressort à 0,282 €/kWh. Le poste énergie pour l’électrique atteint alors ≈ 3 722 € sur cinq ans. Côté essence, 6,5 L/100 km sur 75 000 km conduisent à 4 875 L achetés. Au prix moyen de 1,90 €/L, le carburant représente ≈ 9 263 €. L’écart énergie pèse donc en faveur de l’électrique, avec environ 5 540 € d’économie dans cet exemple.
Maintenance et pièces d’usure
La motorisation électrique réduit les opérations périodiques : pas de vidange d’huile moteur, pas de bougies, pas d’embrayage, peu de pièces mobiles. Les plaquettes bénéficient d’une usure plus lente grâce au freinage régénératif. En revanche, pneus et trains roulants doivent rester surveillés, le poids à vide accroissant parfois l’usure. Sur 75 000 km, l’hypothèse 0,04 €/km donne 3 000 € en électrique, contre 5 250 € en essence à 0,07 €/km. La différence tient aux révisions et aux consommables spécifiques au thermique.
Assurance et fiscalité
Les niveaux d’assurance dépendent du profil conducteur, de la zone, et de la valeur du véhicule. En moyenne, une compacte électrique récente se situe souvent autour de 700 €/an en tous risques, soit 3 500 € sur cinq ans, contre 3 250 € pour l’essence avec 650 €/an. La fiscalité d’immatriculation régionale favorise fréquemment l’électrique via des exonérations de taxe sur la carte grise, alors que l’essence reste soumise au tarif régional par cheval fiscal. Pour un particulier, l’écart carte grise reste marginal face aux autres postes, mais l’avantage va à l’électrique.
Infrastructures de recharge à domicile
L’installation d’un point de charge résidentiel accélère les recharges et sécurise un coût du kWh stable. Dans l’exemple, le chargeur mural et sa pose sont valorisés 900 €. Des aides existent selon la copropriété, le logement et les dispositifs en vigueur. L’accessoire ouvre l’accès à la recharge nocturne en heures creuses et stabilise la dépense d’énergie sur la durée.
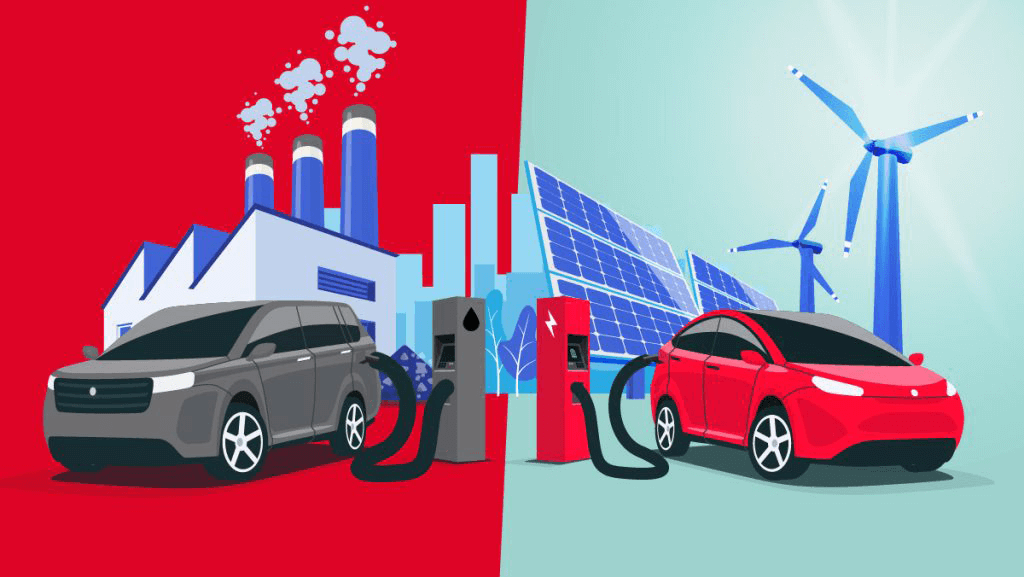
Comparaison chiffrée sur cinq ans
En agrégeant les postes, le véhicule électrique atteint environ 26 372 € sur cinq ans, soit ≈ 0,352 €/km ou ≈ 439,5 €/mois. Le véhicule essence aboutit à 32 763 €, soit ≈ 0,437 €/km ou ≈ 546,0 €/mois. L’avantage en faveur de l’électrique ressort à ≈ 6 390 € sur cinq ans, soit ≈ 106,5 €/mois ou ≈ 0,085 €/km. La hiérarchie provient essentiellement du poste énergie et, dans une moindre mesure, de la maintenance. La dépréciation reste voisine dans ce scénario grâce au bonus à l’entrée et à une valeur résiduelle supposée élevée pour l’électrique.
Sensibilité aux variables
Le résultat varie avec trois leviers majeurs. Tarifs de l’énergie : une part accrue de recharge publique rapide à tarif élevé gonfle la facture électrique, alors qu’un abonnement heures creuses et une planification nocturne à domicile stabilisent les coûts. Prix des carburants : une hausse structurelle de l’essence amplifie l’avantage électrique, une baisse prolongée le réduit. Valeur résiduelle : une cote d’occasion élevée protège la dépréciation de l’électrique, alors qu’une décote rapide inverse la tendance. S’ajoute l’usage autoroutier : à 130 km/h, la consommation électrique augmente sensiblement, d’où un coût au kilomètre supérieur à celui d’un trajet urbain ou périurbain.
Usage principalement urbain
En ville et proche banlieue, l’électrique tire parti d’un rendement énergétique élevé à faibles vitesses et de la régénération. La consommation réelle reste souvent inférieure au cycle mixte, ce qui améliore la ligne énergie. Des économies apparaissent aussi sur les systèmes de freinage grâce à la récupération. Dans ce contexte, la recharge à domicile à tarif résidentiel assure l’essentiel des kWh, ce qui optimise la dépense.
Usage mixte avec autoroute
Sur longs trajets rapides, la consommation électrique augmente sous l’effet de l’aérodynamique et des besoins de chauffage ou climatisation. La part de recharge publique payée au kWh ou à la minute grimpe pendant les voyages, ce qui élève le coût énergétique moyen. L’écart avec l’essence se réduit alors, sans être nécessairement annulé si la base de recharge reste majoritairement résidentielle tout au long de l’année.
Qualité de la batterie et garantie
La santé de la batterie conditionne la valeur d’usage et la revente. Une garantie de huit ans/160 000 km couvrant une capacité minimale (souvent 70 % de l’état d’origine) sécurise l’acheteur et soutient la décote. Une gestion thermique aboutie, des recharges principalement lentes et des niveaux de charge évitant les extrêmes limitent l’usure. Un historique d’entretien à jour et des rapports de diagnostic rassurent le marché de l’occasion.
Maintenance
Groupe motopropulseur : pas d’huile moteur, filtres d’huile, embrayage ou échappement côté électrique. Freinage : réduction d’usure grâce à la régénération, liquide de frein à renouveler périodiquement. Refroidissement : circuit de gestion thermique batterie et électronique à entretenir selon les préconisations. Pneumatiques : masse supérieure qui exige des indices de charge adaptés, surveillance accrue de la pression. Contrôles réglementaires : périodicité inchangée, mais liste d’opérations différente. Cette structure explique l’écart de 0,03 €/km retenu entre les deux énergies.
Assurance, sinistralité et réparation
Les assureurs tariferont sur la base de la valeur du véhicule, de la sinistralité statistique, du coût des pièces et des méthodes de réparation. Des éléments électriques haute tension requièrent des procédures spécifiques et une main-d’œuvre habilitée. L’électronique d’assistance (ADAS) influe également sur les coûts de réparation, quel que soit le moteur. Sur cinq ans, l’écart indicatif de 250 € en faveur du thermique reste faible dans le total.